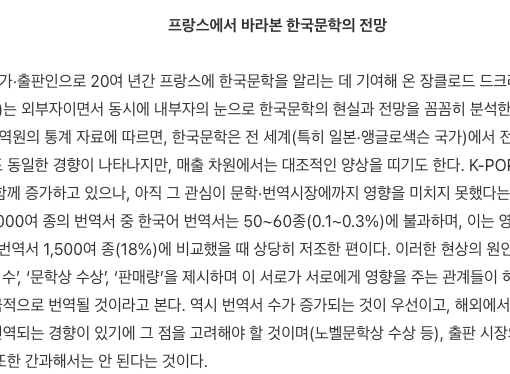Conférence à l’Université Yeonsei-2019
Résumé
Le débat sur l’accès de la littérature coréenne au rang des littératures mondiales est un débat ancien, aussi ancien qu’il est insistant. Dans ce schéma, cette promotion équivaudrait à une reconnaissance internationale. La traduction des œuvres est en règle générale avancée comme étant le moyen prioritaire d’atteindre cet objectif. Pourtant, la position de la littérature coréenne sur la carte des littératures mondiales ne penche pas en faveur de cet objectif. Nous souhaiterions aborder dans le cadre de ce présent article quelques causes de cette apparente désaffection.
Traduction et domination
En France, pays où la littérature coréenne est censée se porter correctement, le volume des traductions décline. Les acteurs de la traduction (traducteurs, éditeurs, organismes de subvention coréens) ne sont pas en cause. Simplement le marché de la littérature coréenne n’est pas encore disponible, voire peut-être plus grave : n’est plus disponible. La France est un pays qui traduit beaucoup, environ 20% de sa production éditoriale, mais cela ne profite pas à la littérature coréenne. Les chiffres sont là pour l’attester. En 2018[1], les traductions de l’anglais se situaient à la première place avec 60% des traductions, suivies du japonais à 12,6%[2], le chinois se situait à 0,6% et les traductions du coréen n’étaient pas mentionnées. Selon le recoupement de plusieurs sources, elles se situeraient entre 0,1 et 0,5 % des traductions. Un chiffre insuffisant pour entrer dans les statistiques officielles. Les chiffres de ces dernières années n’ont pas beaucoup changé : en 2015, la traduction des œuvres coréennes avait baissé de 8%. Les statistiques à partir de 2016 n’intègrent plus la traduction de la littérature coréenne. Par recoupements, j’estime qu’elle se situerait aux alentours de 0,1% des traductions.
En Corée, la situation est identique. On traduit environ 20% de la production éditoriale : la langue anglaise représente 39% des traductions, le japonais 29% et le français 6%[3]. En Corée, la domination des langues anglaise et japonaise semble installée pour longtemps encore. En France, la domination de l’anglais sur toutes les langues est déjà un fait et la domination du japonais sur la traduction des langues asiatiques est avérée depuis de nombreuses années.
La langue anglaise occupe désormais une place de choix. Après tout, cela n’a rien d’inquiétant quand Joyce ou Woolf sont traduits pour notre plus grand bonheur. Mais lorsque 60% des traductions viennent d’une seule langue ou de deux langues (cas de la France et de la Corée) on ne peut plus parler d’inquiétude mais de quasi-invasion. Dans son ouvrage Un désir de littérature coréenne publié en France[4], Jeong Myeong-kyo estimait à juste titre que la traduction était l’une des voies à prendre pour l’accès de la littérature coréenne à la scène mondiale, et —précisait-il, au moins dans un premier temps. Il soulignait aussi que la réception en France des œuvres de Yi Cheongjun, de Hwang Sok-yong, de Lee Seung-u, entre 1990 et 2000, avaient été de petits évènements inscrivant la littérature coréenne dans un domaine particulier influencée par l’histoire du pays et distinguant cette littérature des autres littératures d’Asie, notamment d’Extrême-Orient. À côté de ces auteurs offrant un bel échantillon de la production littéraire coréenne, Yi In-seong, poursuivant une route solitaire, pouvait compléter le panorama, ajoutant une voix singulière, inédite bouleversant autant les codes linguistiques que narratifs et annonçant en Corée, dès les années 70, une autre conception de la littérature, loin des exigences du marché.
La langue anglo-saxonne, couvrant désormais une large surface de la planète, ne régente pas seulement le classement mondial des langues. Si l’on regarde l’attribution des Prix Nobel de littérature, on constate là encore que cette domination règne : 43 % des Prix vont aux langues européennes, 11% à l’anglais des Usa et 2% à la langue japonaise. Sur les 17 derniers Prix Nobel (2000-2017), 7 auteurs écrivent en langue anglaise, soit 41% des lauréats. 2 auteurs écrivent en langue française, soit 11% des lauréats. Deux langues trustent la moitié des attributions de Nobel, l’anglais assurant la grande majorité de ces attributions, même lorsque l’auteur est d’une autre origine (les cas de Naipaul, de Coetzee, de Ishiguro ou encore de Munro). Les premières années du millénaire profitent largement aux langues dominantes, rendant très étroite la marge de manœuvre des langues dominées.
Dans son ouvrage La langue mondiale, Traduction et domination[5], Pascale Casanova affirme qu’il est possible de lutter contre la langue dominante en adoptant la position de l’athée, qui est de ne pas croire au prestige de cette langue. Du Bellay pour la France, Herder pour l’Allemagne, Leopardi pour l’Italie, Khlebnikov pour la Russie, —pour prendre des exemples géographiquement proches et chronologiquement éloignés—, ont montré que la position d’une langue dominante était une position instable, bien qu’elle s’insinue dans toutes les autres langues (le konglish par exemple), toutes les langues avaient la possibilité de leur affirmation esthétique. Car une langue ne domine jamais par son nombre de locuteurs (sinon le Français n’aurait jamais été langue dominante, au regard du nombre de locuteurs chinois ou russes, par exemple), mais par le prestige que lui accordent les locuteurs autant natifs qu’étrangers. Bourdieu indiquait que les langues sont socialement hiérarchisées selon leur proximité au pouvoir (aujourd’hui pouvoir mondial) et selon les profits symboliques qu’elles procurent. Une langue domine quand ses locuteurs croient à la hiérarchie des langues. La reconnaissance du pouvoir de domination d’une langue confère à cette langue un profit symbolique difficile à remettre en cause par les locuteurs comme par les institutions (le cas du chinois en Corée par exemple).
Le modèle linguistique qui s’impose aujourd’hui (l’anglo-américain) est couplé au modèle narratif (le roman américain) et forment paradoxalement pour bon nombre d’auteurs un objectif à atteindre et un point indépassable. On imagine assez aisément à quel point la traduction devient capitale pour la littérature coréenne. Mais de quelle traduction faut-il parler, et peut-on parler de traduction sans parler de genre ou de narration, ou encore de style ? Peut-on encore parler de traduction in abstracto ? Si cette question ne concerne pas directement l’objet du présent article, il y aurait une façon de couper court au débat en affirmant qu’une traduction ne peut pas participer à la domination de la langue qu’elle se propose de présenter. Le problème ne se pose donc pas de savoir si la langue coréenne est une langue littéraire ou non, ou une langue compatible avec les autres langues mondiales, mais de refuser son annexion par les instances dominantes. Ce qui suppose que les agents de cette langue refusent aussi cette domination. Mais il ne s’agit pas seulement de refuser la langue de communication dominante, il s’agit aussi de refuser ce que charrie cette langue, entre autre une culture, une idéologie. Car c’est bien de cela qu’il est question. Les opérations linguistiques, et donc littéraires, n’interviennent jamais dans un désert social, pour paraphraser une formule de Johann Gottfried Herder[6]. La traduction ne peut être le seul levier sur lequel agir pour conduire la littérature coréenne sur la scène mondiale. D’autant plus que cette difficulté à émerger dans le concert mondial des littératures intervient dans un contexte défavorable. Ainsi plusieurs questions se posent, sans que nous puissions répondre à toutes, comme celle-ci par exemple : la scène mondiale des littératures est-elle suffisamment enviable pour que la littérature coréenne ait envie d’y participer ? Quand une domination s’exerce, la reprise des codes de cette domination est très souvent la meilleure façon de la prolonger.
Le déclin symbolique du livre
Alors que, globalement, la lecture ne cesse d’augmenter, via Internet, on lit moins de livres qu’avant et notamment moins de classiques. Dans le même temps, le pouvoir symbolique du livre décroît. Ou plus exactement se déplace. Le livre n’est plus le mode d’accès à la connaissance et la compréhension du monde qui nous entoure, tel qu’il le fût il y a une vingtaine d’années encore. Il ne constitue plus le moyen d’obtenir un profit symbolique. Cette situation rassemble aujourd’hui nos deux pays : l’affaiblissement de la lecture lettrée au profit de la lecture de divertissement. Les statistiques sont de ce point de vue éclairantes. Le lectorat français baisse et la part des « gros lecteurs » baisse également. En 1982, les gros lecteurs, ceux qui lisent entre 25 et 50 livres par an étaient 18% en France. En 1973, 28 % des Français lisaient encore plus de vingt livres par an. En 2008, ils n’étaient plus que 16 %. La part de ces gros lecteurs ne cesse de diminuer, soit par vieillissement (et non remplacement) du lectorat des 50 ans et plus, soit parce que les seniors (60 ans et plus) ont désormais un accès encore plus facile que par le passé au marché des loisirs. Comme le dit avec regret un ami écrivain : Les gens ont trouvé mieux à faire que lire des livres. Les études régulièrement produites sur la consommation des ménages l’attestent : les Français ont diversifié leurs loisirs et la lecture ne représente plus qu’une part mineure dans la consommation des biens culturels, 7,5% en 2015. Lorsque l’espace rétrécit et la ressource se raréfie, c’est toujours au détriment des dominés. Quand on lit moins et que la lecture n’assure plus le profit symbolique du lecteur, quand le nivellement égalitaire joue en faveur du divertissement culturel, le lecteur a toujours tendance à s’orienter vers des lectures qu’il juge valorisantes, estimant sans doute que les littératures étrangères n’en font pas partie ; c’est la raison pour laquelle, l’attribution d’un Prix Nobel ne change rien à la situation des littératures dominées (les littératures égyptienne, hongroise, serbe, grecque ou islandaise ont toutes obtenu un Prix Nobel sans que cela change la position de leur littérature dans le concert des littératures mondiales).
L’hégémonie du roman
Nous sommes entrés dans l’ère, que d’aucuns appellent post-littéraire[7], où le genre romanesque est devenu hégémonique et gouverne l’espace littéraire. Le roman en France représente 25% du chiffre d’affaires des éditeurs. Aux deux rentrées littéraires de janvier et septembre sont publiés près de 1100 romans, parmi lesquels les œuvres des poids lourds mondiaux de l’édition. Les autres genres sont délaissés : journaux intimes, extimes, littéraires, correspondance, essais, chroniques, poésie, textes philosophiques, n’auraient plus les faveurs du public. La littérature coréenne qui parvient en France est presque exclusivement romanesque, roman long ou nouvelle.
Pourtant en leur temps, Sterne, Borgès, Kundera, Handke, Sebald… ont su bouleverser la structure narrative et donner des chefs-d’œuvre. Devon-nous écouter David Shields[8] — prenant acte de la mort du roman tué par la modernité, quand il appelle de tous ses vœux à une jazzification de la littérature ?, c’est-à-dire à une libération des frontières, comme le fit le jazz en son temps. Borges soulignait déjà en 1957 combien il considérait l’histoire du roman comme achevée, que celui-ci ne pouvait plus que se poursuivre dans un “mauvais infini” qui est son “enfer”. Le triomphe absolu du roman est ce pour quoi il disparaît dans un concert de productions éditoriales jumelles. Le thème du roman, l’intrigue, n’auront jamais autant été le moteur de l’écriture par lequel passe l’écrivain (plus exactement l’auteur, le terme d’écrivain étant réservée à notre avis à celui qui fait œuvre dans le silence, hors de la cuisine du champ littéraire). Des histoires vite écrites et vite oubliées, — la vitesse que dénonçait Kundera pouvant s’appliquer ici. Un thème souvent d’origine journalistique, un fait divers à partir duquel l’auteur brode une trame narrative avec une écriture rapide, négligeant non seulement la syntaxe mais toute l’histoire d’une langue et le souffle de cette langue, dialogues abondants, des descriptions absentes au motif qu’elles ennuient le lecteur et alourdissent la rapidité narrative devenue une condition du plaisir de lire. La littérature perdrait ainsi son pouvoir de transformation du lecteur. Abandonnant cette fonction première de la littérature, faisant d’elle un art à part, le romanesque semble aujourd’hui avoir comme objectif de rendre heureux (les good feel books) ou de “réparer” les vies cassées. Ainsi en France est en train de naître un courant littéraire, tel qu’en témoigne le succès de Réparer les vivants, de Maylis de Kérangal[9] (le livre a raflé près de 10 prix littéraires).
Le roman devient hégémonique et dans ce genre, l’influence du roman américain, (si on exclut quelques auteurs majeurs), est par sa forme stylistique et narrative, en train de recouvrir toutes les spécificités régionales, au point que la France comme la Corée peuvent désormais être considérées comme des débouchés culturels américains pour les deux pays. Un brin de chauvinisme nous fera préciser que la Corée est sans doute plus exposée que la France, par son histoire même. Un auteur français, Tanguy Viel s’est amusé à publier un roman La disparition de Jim Sullivan[10] avec l’ambition ironiquement affichée d’imiter les recettes et les ficelles du roman américain apprises dans les formations de creative writing (formations très présentes en Corée et très peu présentes en France, bien que les ateliers d’écriture y fassent florès). Dans ce roman, toutes les recettes du roman américain sont présentes, mais il lui manque le souffle dont les auteurs américains font preuve. On peut pasticher le roman américain, il est difficile de l’imiter.
La structure du roman américain est fortement adossée à la conception cinématographique de la littérature, telle qu’elle est en train de s’imposer. Le roman semble aujourd’hui n’avoir comme but que celui d’être adapté au cinéma (on songe avec tristesse et nostalgie à Jean-Paul Sartre quand il constatait que la littérature devait être bien malade pour faire appel aux arts voisins). Cette littérature bâtie sur quelques ingrédients repérables et industriellement répétés ne requiert nullement le souffle de la langue mais vise plutôt la performance narrative devant conduire le lecteur à un easy reading, noble rançon de l’easy writing par lequel elle a été produite.
Les autres genres
Certes, les textes poétiques et de théâtre coréens sont toujours édités en France, mais ils n’assurent malheureusement pas à eux seuls la visibilité d’une littérature riche de genres et d’œuvres. C’est donc une littérature réduite à un genre qui se confronte aux autres littératures sur les rayons de libraires. Tandis qu’en 2015 le volume des traductions du coréen baissait de 8%, le volume des romans coréens publiés augmentait de 22%. Cette production se confronte inéluctablement à la production concurrente. Or une des règles de la concurrence (nous sommes là, loin de la littérature) est de ne jamais imiter ceux qui sont en position de force). Autrement dit, les littératures dominées ne sont pas contraintes d’imiter les littératures dominantes. C’est la chance de la littérature coréenne, étouffée d’un côté par la littérature anglo-américaine et de l’autre côté par la littérature japonaise, que de proposer la diversité de sa production, en abordant la question des genres littéraires. Or, nous avons vu qu’en dehors de la fiction, il se traduisait peu d’autres genres. Les textes de sciences humaines venus de Corée sont quasi-inexistants. Les seuls livres philosophiques qui nous parviennent sont l’œuvre du philosophe coréen Han Byung-cheol, traduits de l’allemand. Or, si c’est de littérature que nous parlons et non pas seulement de production romanesque, il convient de penser la traduction et l’édition d’ouvrages de sciences, au sens large du terme, qui ont une vocation générale et peuvent donc être lus un peu partout sur la planète. Par exemple, en France, nous manquons cruellement d’ouvrages développés de l’histoire de la littérature coréenne et de la philosophie coréenne. En d’autres termes, nous avons besoin de lire une pensée spécifiquement coréenne, distinctive de ses collègues orientales, venant se confronter aux textes occidentaux. Est-il bien normal, qu’au moment où de nombreux savants d’Occident se penchent sur l’avenir de la planète, nous n’ayons aucune voix ou presque qui nous vient de Corée ?
Le style
Signe des temps, l’oralité est devenu un marqueur de bon nombre de romans. Influencée par le cinéma, l’oralité est devenu un style jugé plus immédiat, plus convivial, plus authentique, réclamant un moindre effort de lecture. Il permet aussi une immédiateté de “l’image” destinée à fabriquer des émotions plus accessibles pour le lecteur qui est devenu un lecteur moyen. L’histoire racontée est considérée dans notre monde télévisuel comme l’unique facteur d’intérêt. Le roman devient “scénarisé”, quitte à rendre l’histoire fantasmagorique, susceptible d’aider au surgissement d’une émotion rapidement digérée, car le roman ne doit pas provoquer d’accident de lecture, il doit couler comme l’eau de la rivière. Il y a quelques semaines, un canular littéraire a été lancé par deux écrivains français : ils ont envoyé à 19 éditeurs “petits et grands” les 50 premières pages de Le palace, un roman de Claude Simon, prix Nobel de littérature 1985. Il s’git d’une phrase qui s’étale sur 9 lignes, avec 4 couples de parenthèses et une abondante série de virgules. Elle décrit l’atterrissage d’un pigeon sur un balcon. L’instant qui ne dure que quelques secondes est étiré par le style du Prix Nobel, que l’Académie Nobel consacrait sous cette forme : Pour saluer “…celui qui, dans ses romans, combine la créativité du poète et du peintre avec une conscience profonde du temps dans la représentation de la condition humaine ». Claude Simon travaillait la langue par une ponctuation inédite, ou bien sans ponctuation, avec de très longues phrases, répétant, digressant sans jamais faillir. 7 éditeurs n’ont pas répondu et 12 ont décliné la proposition d’édition. L’un deux a répondu en ces termes : Les phrases sont sans fin, faisant perdre totalement le fil au lecteur. Le récit ne permet pas l’élaboration d’une véritable intrigue avec des personnages bien dessinés. Un prix Nobel de littérature 1985 ne serait donc pas édité de nos jours. Si l’écrivain dit le monde en même temps qu’il se dit lui-même, —l’ordre des propositions pouvant s’inverser—, la responsabilité du style n’en prend que plus d’acuité au motif que c’est par le style que l’auteur prend le surplomb nécessaire à son regard. Une parole singulière ne peut se tenir dans une langue de tous les jours.
La littérature, c’est d’abord une langue, autrement dit, un style. Plusieurs auteurs français insistent sur l’inquiétude, assez largement partagée, que la littérature serait en manque de valeur, parce que la littérature ne s’écrirait plus, qu’elle ne fonde plus sa croyance dans le fétichisme de la langue. Philippe Vilain[11] met en cause la volonté des écrivains de se rendre le plus lisible possible, dans une visée commerciale, en racontant une histoire susceptible de toucher le registre émotionnel du lecteur, plus que son registre réflexif. De la sorte, la littérature se serait orientée vers le désécrire, ruinant l’idée même de littérature, finalité dont Céline fut le chantre. L’écrit, pur produit d’un story-board et ambassadeur d’un storytelling, conduisant dans une alternance de descriptions et de dialogues, à raconter une histoire susceptible d’émouvoir le lecteur, sans se préoccuper de la dette que tout auteur doit à la langue. Dans son manifeste fondateur de la littérature dite « moderne ». À l’orée du XXe siècle, Yi Gwansu n’attribuait pas d’autre mission à la littérature que celle de transmettre des émotions. Version éminemment contestable mais, il semblerait qu’après s’en être éloigné, bon nombre d’auteurs coréens soient revenus à cette conception. Le style littéraire rangé au rayon de fioritures, l’écrit se concevrait dorénavant en images, l’assemblage de ces images ayant pour vocation de donner à voir. La littérature comme art visuel. La désertion du style s’accompagne d’une nouvelle architecture de la forme, la pensée « images » n’étant jamais aussi bien servie que par l’oralisation. Les conditions sont prêtes pour une littérature de divertissement, rôle auquel le roman semble s’être résolu. La littérature du « raconter » a sans doute gagné sa bataille contre la littérature du « penser », le « désécrit » contre le style.
Consécutivement, l’économie du livre et les conditions sociales de production chez les auteurs ont contribué à modifier la donne : l’affaiblissement de la demande de lecture s’associe à l’affaiblissement généralisé (disparition d’enseignements, place de la littérature dans les médias, etc.). La situation n’est évidemment pas propre à la France et les mêmes phénomènes s’observent en Corée. Les formations universitaires à l’écriture ou les ateliers privés d’écriture peuvent devenir problématiques pour la diversité stylistique. Fort heureusement, il reste des auteurs pour qui la littérature est, et reste, une voix singulière. Mais lorsque la littérature n’a plus de visée politique, plus d’ambition esthétique et n’est plus un objet de savoir, que lui reste-t-il ? Une belle histoire à raconter ?
Vers la fin du post-littéraire
Prenant acte que la littérature se perd dans un processus de dévalorisation continue de sa propre histoire, Willian Marx, historien de la littérature, montre que la littérature est non seulement attaquée de l’extérieur[12] mais aussi de l’intérieur[13]. L’accès de la littérature coréenne à la scène mondiale ne peut s’examiner en dehors des contraintes qui pèsent sur la littérature en général et sur le monde de l’édition en particulier. Dit autrement, l’émergence et la reconnaissance d’une littérature ne reposent pas seulement sur les qualités intrinsèques de cette littérature. Sans quoi, les auteurs publiés dans les années 90 en France, Yi Cheong-jun, Yi Munyol, Choi In-hun, de très grands écrivains, auraient ouvert un chemin que l’on emprunterait encore aujourd’hui. Or, il n’en est rien. Pour les raisons évoquées plus haut, le roman coréen se heurte en France aux littératures (entendues ici au sens de multiples genres) installées de longue date. Dans un contexte de resserrement de la lecture, la primeur est donnée aux valeurs du groupe dominant. C’est ce groupe qui, imposant ses règles linguistiques et esthétiques, confine les groupes minoritaires dans une marge dont il est difficile de sortir.
Si la traduction continue d’être indépassable pour l’accès d’un public à une œuvre, elle ne peut à elle seule constituer le seul espace réflexif. Sur la traduction en elle-même, beaucoup de choses ont été dites et il paraît pour le moins difficile d’apporter du neuf en la matière. Comme pour la réception des oeuvres, c’est à une véritable économie de la traduction qu’il faut se confronter, en tenant compte non seulement du clivage des littératures dominantes/dominées mais aussi de l’histoire de la traduction des œuvres coréennes en France. La littérature coréenne ne peut plus seulement exporter de la fiction, comme le cinéma coréen a pu le faire. Et ignorer les mécanismes de sélection des œuvres qui s’opèrent dans les flux industriels. La concentration des maisons d’édition et surtout des sociétés de diffusion pose un véritable problème. On observe que dans les derniers mois, deux des plus gros diffuseurs ont cessé de diffuser des petites maisons d’édition ne rapportant pas assez de profits. D’ici à la fin de l’année, le risque de voir une centaine de petites maisons d’édition sans diffuseur est grand. Les littératures dominées souffriront plus que les littératures dominantes dans ce contexte de concentration.
Conclusion
La littérature coréenne a été introduite en France par vagues successives, dans lesquelles on peut compter parmi les auteurs les plus importants, tels que Yi Cheongjun, Yi Munyol, Choe Inhun, pour les années 90. Lee Seung-u, Hwang Seok-yong, pour les années 2000. Dans ces deux périodes, la traduction a joué un rôle fondamental dans la réception du public. La plupart des traductions étaient des romans et ces romans venaient se confronter sur le marché symbolique à des littératures déjà installées, dont le passé et le capital traduction pouvaient être difficilement menacés. Depuis les années 2010, ce sont d’autres œuvres qui sont traduites, d’auteurs plus jeunes, aux thèmes d’écriture que nous qualifions de mondialisés, au sens où on peut retrouver ces thèmes dans bon nombre de littératures. Ces traductions interviennent dans un contexte principalement marqué par un affaiblissement de la lecture, une prédominance des traductions anglo-saxonnes et une concentration industrielle en défaveur des littératures dominées.
Dans un tel contexte, la traduction ne suffit plus à elle seule pour donner à lire l’originalité de la littérature coréenne. Paradoxalement, c’est sans doute sur ce dernier point que réside la chance de la littérature coréenne traduite en France. Résister. En offrant des textes inclassables, des textes qui contribuent à transformer ses lecteurs. Des textes dans lesquels la langue est au coeur du projet. C’est par la langue que nous accédons à la littérature, une langue qui ne se résume pas à un agencement satisfaisant de mots, à “un joli style”; car il n’y a pas de style si l’intériorité de l’auteur ne fait pas surface, si l’écriture ne provient pas du plus profond de l’ombre et de la mort comme se plaît à l’affirmer l’un des plus beaux “stylistes” français, Richard Millet : En fin de compte, on n’écrit que pour rendre hommage à la langue, la louer ou témoigner d’elle.
Bibliographie
Casanova, Pascale, La langue mondiale, Traduction et domination, Seuil, 2015, Paris
Casanova, Pascale, La république mondiale des lettres, Seuil, 1999, Paris
Jeang, Myeong-kyo, Un désir de littérature coréenne, Decrescenzo Éditeurs, 2015, Aix-en-Provence
Marx, William, L’adieu à la littérature, Minuit, 2005, Paris
Marx, William, La haine de la littérature, Minuit, 2015, Paris
Millet, Richard, L’enfer du roman, Gallimard, 2010, Paris
Vilain, Philippe, La littérature sans idéal, Grasset, 2016, Paris
[1] Source : Direction du Livre, Ministère de la Culture, Observatoire de l’économie du livre, 2019
[2] Principalement des traductions de manga, il est vrai.
[3] Source : Centre du management de l’information de l’Association des éditeurs de Corée, 2014
[4] Decrescenzo éditeurs, 2015
[5] Pascale Casanova, La langue mondiale, Traduction et domination, Seuil, 2015, Paris
[6] Johann Gottfried von Herder,poète, théologien et philosophe allemand (1744-1803).
[7] Courant de réflexion des années 90, annonçant le dépassement de la littérature par la destruction du langage et le triomphe du roman sur les autres genres et sur les textes inclassables.
[8] Écrivain américain.
[9] Publié en Corée chez Open Books
[10] Éditions Minuit, 2017
[11] Vilain, Philippe, La littérature sans idéal, Grasset, 2016, Paris
[12] La haine de la littérature, Les Éditions de minuit, 2015, Paris.
[13] L’Adieu à la littérature, Les Éditions de minuit, 2005, Paris.